„Aceste trăsături”, scria romancierul și semioticianul, „nu pot fi organizate într-un sistem; multe dintre ele se contrazic și sunt, de asemenea, tipice altor tipuri de despotism sau fanatism. Dar este suficient ca una dintre ele să fie prezentă pentru a permite fascismului să se coaguleze în jurul său”.
1. Cultul tradiției. „Trebuie doar să ne uităm la programa fiecărei mișcări fasciste pentru a găsi principalii gânditori tradiționaliști. Gnoza nazistă a fost hrănită din elemente tradiționaliste, sincretiste, oculte. ”
2. Respingerea modernismului. „Iluminismul, epoca rațiunii, sunt văzute ca începutul depravării moderne”.
3. Cultul acțiunii de dragul acțiunii. „Acțiunea, fiind frumoasă în sine, trebuie făcută înainte sau fără orice reflecție anterioară. Gândirea este o formă de emasculare”.
4. Dezacordul este trădare. „Spiritul critic face distincții, iar distincția este un semn al modernismului. În cultura modernă, comunitatea științifică laudă dezacordul ca o modalitate de a îmbunătăți cunoștințele”.
5. Teama de diferență. „Primul apel al unei mișcări fasciste sau prematur fasciste este unul împotriva intrușilor. Astfel, Ur-Fascismul este rasist prin definiție”.
6. Apel la frustrarea socială. „Una dintre cele mai tipice trăsături ale fascismului istoric a fost apelul către o clasă de mijloc frustrată, o clasă suferind de o criză economică sau sentimente de umilință politică”.
7. Obsesia pentru un complot. „Astfel, la rădăcina psihologiei ur-fasciste există obsesia pentru un complot, posibil unul internațional. Adepții trebuie să se simtă asediați”.
8. Inamicul este și puternic, și slab – aceasta, prin schimbarea continuă a focalizării retorice.
9. Pacifismul este o formă de tranzacționare cu inamicul.
10. Dispreț pentru cei slabi. „Elitismul este un aspect tipic al oricărei ideologii reacționare”.
11. Cu toții sunt educați să devină eroi. „În ideologia ur-fascistă, eroismul este norma. Acest cult al eroismului este strict legat de cultul morții”.
12. Machism și cultul armelor. „Machismul implică atât dispreț pentru femei, cât și intoleranță și condamnare a obiceiurilor sexuale nestandardizate, de la castitate la homosexualitate.”
13. Vocea Poporului, prezentată în mod selectiv. „Există un populism în care răspunsul emoțional al unui grup selectat de cetățeni poate fi prezentat și acceptat ca fiind Vocea Poporului”.
14. Ur-Fascismul vorbește Noua Limbă. „Toate manualele naziste sau fasciste au folosit un vocabular sărăcit și o sintaxă elementară, pentru a limita instrumentele unui raționament complex și critic.”
Dacă unele dintre aceste idei și comportamente, zugrăvite de Umberto Eco acum un sfert de secol, vi se par astăzi mai prezente decât oricând în spațiul public, s-ar putea să aveți dreptate să vă îngrijorați.
Le 25 avril 1995, Umberto Eco s’adressait aux étudiants de Columbia University (New York) pour leur parler du fascisme italien au milieu duquel il avait grandi (il naquit en 1932) et plus généralement de tous les fascismes. Avec une prescience bien dans son style, il mettait en garde ces mêmes étudiants contre la montée des partis et mouvements populistes, montée qui se dessinait aux USA comme en Europe. Et de désigner ceux-ci par l’heureuse formule de « fascismes en civil ».
Dans son exposé, Eco commençait par revenir de façon amusante sur son enfance italienne. Je fus, avouait-il, un fasciste en herbe puisque tous les gamins italiens l’étaient. En ce temps-là, ne remportait-il pas un concours dont le thème était : « Faut-il mourir pour la gloire de Mussolini ? » ? À quoi il répondit crânement (?) par l’affirmative, pour noter plus tard : « J’étais un petit garçon très éveillé ». Garçon éveillé qui, à la Libération, découvrait qu’il y avait eu la Résistance, qu’il existait une pluralité de partis sortant de l’ombre et que les confrontations meurtrières entre partisans et chemises noires se poursuivaient.
Tout cela le conduisit bien plus tard à la question : existe-t-il un fascisme fondamental, un « Ur-fascisme » ? Ce sera le thème essentiel de la conférence de Columbia, reprise aujourd’hui en un petit volume. Si l’on s’en tient à l’Italie du Duce, estime Eco, le fascisme ne sut jamais se revendiquer d’une philosophie cohérente. « Mussolini n’avait aucune philosophie, il n’avait qu’une rhétorique » (p. 23), écrit celui qui, sémiologue, devint plus tard le spécialiste de toutes les rhétoriques. Et de mettre en évidence le côté salmigondis d’une doctrine à travers cet exemple : « Il (Benito Mussolini) commença comme athée militant pour finir par signer le Concordat avec l’Église et accueillir à bras ouverts les évêques qui bénissaient les insignes fascistes. » (ibid.). Cela allait donc dans tous les sens et — autre exemple — l’adhésion du futurisme de Marinetti à la ligne fasciste fut une aberration puisque le poète prônait un avant-gardisme d’inspiration technologique qui eût dû être mis au rang de l’art dégénéré.
Il convient néanmoins, et c’est la tâche à laquelle s’attache la conférence de Columbia, de dégager une série d’archétypes qui, réunis, fondent comme un fascisme éternel. Pour Eco, les concepts en question sont une bonne douzaine mais, remarque l’auteur, ils ne sont jamais tous présents dans la doctrine d’un parti donné, même si le nazisme hitlérien en proposa une version assez complète et d’autant plus sinistre.
Le plus souvent, tout fascisme est donc un collage hétéroclite d’éléments de doctrine. Avec pour principaux thèmes faisant office de piliers aisément repérables : le traditionalisme, la haine du modernisme, le nationalisme, le racisme, le machisme. Ceux-là sont toujours prêts à resurgir, même si aujourd’hui ils veillent à s’avancer masqués. C’est bien le cas du « marinisme » en France, bien plus rusé, comme on sait, que le fascisme paternel.
 Mais le plus intéressant et le plus innovant dans le présent inventaire est ce qui touche à une sociologie du fascisme. C’est que, en règle générale, l’idéologie en cause naît d’une vaste frustration individuelle et sociale. Il suffit parfois de se mêler au public d’un stade de foot pour le comprendre. De là, cette tendance commune aux populismes à puiser dans la population des classes moyennes telles qu’elles sont en perte de vitesse et telles qu’elles absorbent l’ancien prolétariat. Telles aussi qu’elles haïssent et rejettent les étrangers tantôt perçus comme opulents et tantôt comme misérables.
Mais le plus intéressant et le plus innovant dans le présent inventaire est ce qui touche à une sociologie du fascisme. C’est que, en règle générale, l’idéologie en cause naît d’une vaste frustration individuelle et sociale. Il suffit parfois de se mêler au public d’un stade de foot pour le comprendre. De là, cette tendance commune aux populismes à puiser dans la population des classes moyennes telles qu’elles sont en perte de vitesse et telles qu’elles absorbent l’ancien prolétariat. Telles aussi qu’elles haïssent et rejettent les étrangers tantôt perçus comme opulents et tantôt comme misérables.
Or, ce populisme-là se transforme aisément en élitisme de masse : nous sommes les meilleurs, nos chefs son dignes d’une aristocratie, ils nous rendent prêts à vivre héroïquement, car il y va d’une vie pour la lutte plus que d’une lutte pour la vie. De cet élitisme de masse, on passe pour suivre à ce qu’Eco nomme un populisme qualitatif. « Pour l’Ur-fascisme, précise l’auteur, les citoyens en tant que tels n’ont pas de droits, et le « peuple » est conçu comme une qualité, une entité monolithique exprimant la « volonté commune ». Puisque aucune quantité d’êtres humains ne peut posséder une volonté commune, le Leader se veut leur interprète. » (p. 46). De là, le danger que peut représenter aujourd’hui la communication « immédiatiste » qui passe par internet et ses versions Twitter ou Facebook. C’est aussi une volonté commune. On voit pourquoi un Trump en use et abuse.
Relisons donc Umberto Eco, qui certes n’a pas connu Trump ni ses succédanés mais qui était vigilant. Et relisons sa conférence de Columbia qui nous alerte utilement à l’égard d’un fascisme de toujours qui, sous des dehors nouveaux et au gré d’une mise à jour de ses archétypes, nous menace aujourd’hui.
Umberto Eco, Reconnaître le fascisme, traduit de l’italien par Myriem Bouzaher, Grasset, 2017, 56 p., 3 € — Lire un extrait
RECONNAÎTRE LE FASCISME
EN 1942, À L’ÂGE DE DIX ANS, j’ai remporté le premier prix aux Ludi
Juveniles (un concours à libre participation forcée pour jeunes
fascistes italiens – lisez, pour tous les jeunes Italiens). J’avais brodé
avec une magistrale rhétorique sur le sujet : « Faut-il mourir pour
la gloire de Mussolini et le destin immortel de l’Italie ? » Ma
réponse était affirmative. J’étais un petit garçon très éveillé.
Puis, en 1943, je
découvris le sens du mot Liberté. Je vous raconterai cette histoire à la fin de
mon propos. À ce moment-là, liberté ne signifiait pas
encore Libération.
J’ai passé deux de mes premières années
entre S.S., fascistes et partisans qui se tiraient dessus, et j’ai appris à
éviter les balles, un exercice qui ne fut pas inutile.
En
avril 1945, les partisans prirent Milan. Deux jours plus tard, ils
arrivèrent dans la petite ville où je vivais. Un grand moment de joie. La place
principale était noire de monde, tous chantaient, agitaient des drapeaux,
scandaient en hurlant le nom de Mimo. Chef des partisans de la zone, Mimo,
ex-maréchal des carabiniers, s’était rangé aux côtés de Badoglio et avait perdu
une jambe lors d’un des premiers accrochages. Pâle, appuyé sur des béquilles,
il apparut au balcon de la mairie ; d’une main, il demanda à la foule de
se calmer. Moi, j’attendais son discours, puisque mon enfance avait été marquée
par les grands discours historiques de Mussolini, dont nous apprenions par cœur
à l’école les passages
les plus significatifs. Silence. D’une voix rauque, presque inaudible, Mimo
parla : « Citoyens, mes amis. Après tant de douloureux sacrifices...
nous y voici. Gloire à ceux qui sont tombés pour la liberté. » Ce fut
tout. Et il retourna à l’intérieur. La foule criait, les partisans levèrent
leurs armes et tirèrent en l’air joyeusement. Nous, les enfants, nous nous
précipitâmes pour récupérer les douilles, précieux objets de collection, mais
je venais aussi d’apprendre que liberté de parole signifiait liberté quant à la
rhétorique.
Quelques jours
après, je vis arriver les premiers soldats américains. Il s’agissait
d’Afro-Américains : mon premier Yankee était un Noir, il s’appelait Joseph
et m’initia aux merveilles de Dick Tracy et de Li’l Abner. Ses bandes
dessinées étaient en couleurs et elles sentaient bon.
La famille de deux
de mes camarades de
classe avait mis sa villa à la disposition de l’un des officiers – le
major ou capitaine Muddy. Je me sentais chez moi dans ce jardin où des femmes
parlant un français approximatif faisaient cercle autour de lui. Le capitaine
Muddy avait fait des études supérieures et il connaissait un peu le français.
Ainsi, ma première image de libérateurs américains, après tant de visages pâles
en chemise noire, fut celle d’un Noir cultivé en uniforme vert-jaune qui
disait : « Oui, merci beaucoup Madame, moi aussi j’aime le
champeigne... » Malheureusement, du champagne, il n’y en avait pas,
mais le capitaine Muddy m’offrit mon premier chewing-gum et je me mis à mâchouiller
toute la sainte journée. La nuit, je le mettais dans un verre d’eau afin de le
garder au frais pour le lendemain.
En mai, nous sûmes
que la guerre était finie. La paix me fit un drôle d’effet. La guerre permanente était
– m’avait-on dit – la condition normale pour un jeune Italien. Les
mois suivants, je découvris que la Résistance n’était pas un phénomène local
mais européen. J’appris des mots nouveaux et excitants comme réseau,
maquis, armée secrète, Rote Kapelle, ghetto de Varsovie. Je vis les
premières photographies de l’Holocauste et en compris la signification avant
que d’en connaître le mot. Je me rendis compte de quoi nous avions été libérés.
En Italie, il se
trouve aujourd’hui des gens qui se demandent si la Résistance a eu un impact militaire
réel sur le cours de la guerre. Pour ma génération, la question est nulle et
non avenue : nous avons tout de suite compris la signification morale et
psychologique de la Résistance. Nous tirions orgueil, nous Européens, de ne pas
avoir attendu passivement la Libération. Et il me semble que pour les jeunes Américains venus
verser leur tribut de sang à notre liberté, il n’était pas négligeable de
savoir que, derrière les lignes, des Européens payaient déjà leur dette.
En Italie, il se
trouve quelqu’un pour affirmer aujourd’hui que le mythe de la Résistance était
un
mensonge communiste. Certes, les communistes ont exploité
la Résistance comme une propriété personnelle, puisqu’ils y ont joué un rôle
prépondérant ; mais moi, j’ai le souvenir de partisans portant des
foulards de couleurs différentes.
L’oreille collée à
la radio – les fenêtres fermées et le black-out général faisant de
l’espace exigu autour de l’appareil le seul halo lumineux –, je passais
mes nuits à écouter les messages de Radio Londres aux partisans. À la fois
obscurs et poétiques (« Le soleil se lève encore », « Les roses
fleuriront »), la majeure partie d’entre eux s’adressait « à ceux de
Franchi ». On me susurra que Franchi était le chef d’un des groupes
clandestins les plus puissants de l’Italie du Nord, un homme au courage
légendaire. Franchi devint mon héros. Franchi – Edgardo Sogno de son vrai
nom – était un monarchiste, tellement anticommuniste qu’après la guerre il
rejoignit un groupe d’extrême droite et fut même accusé d’avoir collaboré
à une tentative de coup d’État réactionnaire. Mais qu’importe ? Sogno
restera toujours Sogno, le rêve de mon enfance. La Libération fut l’entreprise
commune de gens de couleurs différentes.
En Italie, il se
trouve quelqu’un pour dire aujourd’hui que la guerre de Libération fut une
tragique période de division, et que nous avons maintenant besoin d’une
réconciliation nationale. Le souvenir de ces terribles années devrait être refoulé. Seulement voilà, le
refoulement est source de névroses. Si réconciliation signifie compassion et
respect pour ceux qui ont livré leur guerre de
bonne foi, pardonner ne signifie pas oublier. Je pourrais
même admettre qu’Eichmann croyait sincèrement en sa mission, mais je ne me vois
pas en train d’affirmer « OK, reviens et recommence ». Nous sommes là
pour rappeler ce qui s’est passé et déclarer solennellement
qu’« ils » ne doivent pas recommencer.
Mais qui,
« ils » ?
Si l’on se réfère
aux gouvernements totalitaires ayant dominé l’Europe avant la Seconde Guerre
mondiale, on peut affirmer sans crainte qu’il serait difficile de les voir
revenir sous la même forme dans des circonstances historiques différentes. Si
le fascisme de Mussolini se fondait sur l’idée d’un chef charismatique, le
corporatisme, l’utopie du « destin fatal de Rome », sur une volonté impérialiste
de conquérir de nouvelles terres, sur un nationalisme exacerbé, sur l’idéal de
toute une nation embrigadée en chemises noires, sur le refus de la démocratie
parlementaire, et l’antisémitisme, alors je n’ai aucun mal à admettre que Alleanza
Nazionale, issu du MSI (Mouvement Social Italien), est certainement un
parti de droite mais qu’il n’a pas grand-chose à voir avec l’ancien fascisme.
Pour des raisons identiques, même si je suis préoccupé par les divers
mouvements pronazis actifs çà et là en Europe, Russie comprise, je ne pense pas
que le nazisme, sous sa forme originale, soit en passe de renaître en tant que
mouvement capable d’impliquer une nation entière.


























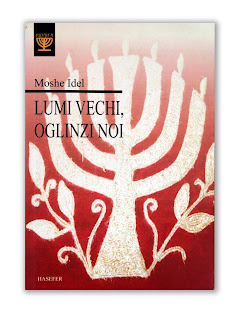




















 Mais le plus intéressant et le plus innovant dans le présent inventaire est ce qui touche à une sociologie du fascisme. C’est que, en règle générale, l’idéologie en cause naît d’une vaste frustration individuelle et sociale. Il suffit parfois de se mêler au public d’un stade de foot pour le comprendre. De là, cette tendance commune aux populismes à puiser dans la population des classes moyennes telles qu’elles sont en perte de vitesse et telles qu’elles absorbent l’ancien prolétariat. Telles aussi qu’elles haïssent et rejettent les étrangers tantôt perçus comme opulents et tantôt comme misérables.
Mais le plus intéressant et le plus innovant dans le présent inventaire est ce qui touche à une sociologie du fascisme. C’est que, en règle générale, l’idéologie en cause naît d’une vaste frustration individuelle et sociale. Il suffit parfois de se mêler au public d’un stade de foot pour le comprendre. De là, cette tendance commune aux populismes à puiser dans la population des classes moyennes telles qu’elles sont en perte de vitesse et telles qu’elles absorbent l’ancien prolétariat. Telles aussi qu’elles haïssent et rejettent les étrangers tantôt perçus comme opulents et tantôt comme misérables.