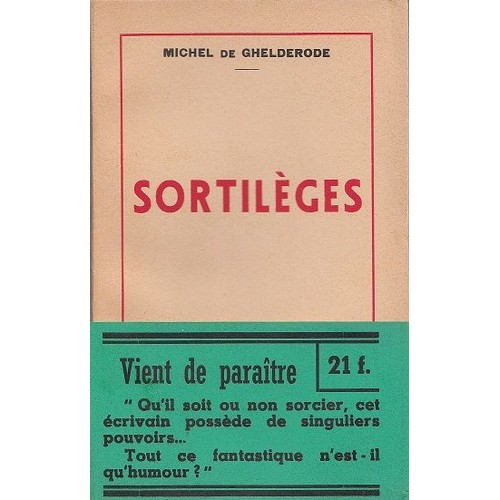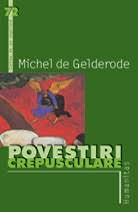Parution: 1941
Hé oui, encore un auteur belge. Mais tant qu’à être en Belgique, autant en profiter. Michel est connu surtout pour son œuvre théâtrale teintée de symbolisme et de fantastique (un peu). Même que si y était pas mort avant, y aurait peut-être gagné le prix Nobel en 1962. Sortilèges, c’est un recueil de 12 nouvelles fantastiques. 4e de couverture :
« Mannequins de cire, diables, Méphisto, vieilles dames d’âge indéfinissable, vieux antiquaires et statues peuplent les douze contes fantastiques de ce recueil. La mort et le péché y traversent des décors qui suggèrent un monde de la décrépitude, des odeurs méphitiques, des brumes et de la laideur envahissante. »
C’est le narrateur qui crée la cohésion dans le recueil; c’est un Je qui rappelle celui de Poe, genre intello blasé qui souffre du spleen. Facque c’est à peu près le même narrateur dans chaque nouvelle. Y a deux genres de contes dans le recueil : les contes plus sérieux pi ceux qui le sont moins. J’aime mieux les premiers. Encore une fois, ça rappelle Poe, qui peut écrire des trucs sérieux, dark pi toute pi ensuite une autre affaire genre Discussion avec une momie. Anyway. Autre facteur de cohésion aussi : l’atmosphère. Toujours un ciel bas, gris, le soleil qui se couche, la ville sale, les rues crottées, un brouillard qui plane continuellement. L’atmosphère fantastique par exellence.
Vu que c’est chiant de critiquer un recueil de nouvelles, je vais me limiter à celle que j’ai aimé le plus : Le jardin malade. Sous la forme du journal intime, cette nouvelle relate les jours qui suivent l’aménagement d’un homme et son chien dans leur nouvelle maison. Évidemment, c’est une vieille maison mystérieuse pi épeurante. Dans la cours arrière, y a une huge jardin-jungle qui le chien semble éviter. Ensuite y arrive des affaires. Extrait :
« Le spectacle de la végétation devenue monstrueuse avec l’âge n’est pas sans induire au malaise, même à la crainte, non pour ce qu’elle doit contenir de vie animale, mais pour ce qu’elle exprime de force inéluctable. Les lierres, les glycines, les vignes vierges se livrent un combat de poulpes, étouffant les arbustes et bousculant les murailles. »
Il parait que le jardin, c’est la transposition littéraire de l’angoisse vécue par l’auteur pendant toute sa vie. Peut-être, mais seul Roland Barthes connait la vérité à ce sujet. On fini par apprendre que le jardin pousse sur un ancien cimetière genre Poltergeist.
Le texte est bien construit, en gradation du fantastique jusqu’à la toute fin, volontairement pas claire pour nous faire chier, ou pour nous faire réfléchir. Le récit oscille tout le temps entre réel pi fantastique, faisant qu’on est jamais certain de rien. Même les descriptions donnent cet effet :
« [Le chat] était d’une taille extraordinaire, le poil rare, et comme atteint d’une lèpre qui donnait à sa peau les tons morbides, roux, bruns, crémeux des murailles avec lesquelles – mimétiquement – il se confondait. […] Toutefois, l’horreur que j’éprouvais à sa vue ne venait pas de sa condition physique, les croûtes et purulences m’inclinaient plutôt à la pitié; ce sentiment venait de l’expression diabolique de la tête, une tête plate, presque d’un serpent, trouée de prunelles sanguignolentes, par instants dilatées, puis s’éteignant dans une sanie blanche. »
Je sais toujours pas c’était quoi ce chat-là. Probablement encore la réflexion de l’angoisse de l’auteur, c’est plus facile demême. De Ghelderode a un talent fou pour décrire ses personnages, toujours déformés, d’une façon vraiment dégueuse. C’est pas présent particulièrement dans cette nouvelle-là, mais dans les autres oui. Pi son fantastique est toujours sous la forme d’apparitions pas trop claires, de monstres filtrés dans le brouillard ou la folie du narrateur. Comme Poe. Mais c’est normal, l’auteur le sait pi se réclame de notre ami Edgar. Facque c’est correct.
Le style de Ghelderode coule ben; mais son point fort c’est qu’il réussi à nous englober dans son atmosphère lugubre, à la projetter sur son lecteur. Ce qui est ben ben dur à faire. Mais lui il réussi. (Hypothèse : j’ai comme l’impression que les auteurs fantastiques européens donnent plus d’importance au style que les américains, qui semblent s’en câlisser pas mal, d’écrire bien. À développer.)
Verdict : je le conseille, y a ben une couple de nouvelles qui valent la peine d’être lues là-dedans. Pour ceux qui aiment les atmosphères sombres pi les apparitions lugubres.
-------------------------------------------------------------------------------------------


Les "Sortilèges" sont des contes de l'écrivain belge d'expression française Michel de Ghelderode (pseudonyme de Michel Martens, 1898 - 1962), publiés d'abord en 1941, puis en édition définitive en 1947 (préface de Franz Hellens). Le recueil comprend douze contes : " L'écrivain public ", " Le diable à Londres ", " Le jardin malade ", " L'amateur de reliques ", " Rhotomago ", " Sortilèges ", " Voler la mort ", " Nuestra Senora de la Soledad ", " Brouillard ", " Un crépuscule ", " Tu fus pendu ", " L'odeur de sapin ".
L'inavouable joie de la mort vécue ; l'intolérable volupté du cri et de l'amour se consumant lui-même au seuil de la prostitution, du mal, de l'horreur ; l'évocation des fantômes ressuscitant des plus effroyables ténèbres un spectacle universel, un théâtre spectral ; l'imperfection des sens et leur dépassement ; la joie presque mystique du non-respect des interdits ; la défense dans son obscénité " violette ", de la solitude ; tels sont quelques-uns des thèmes majeurs obsessionnels- de ces contes. Il y a lieu d'insister sur le rôle prédominant qu'a joué l'odeur dans l'imagerie de Ghelderode. En effet, l' odeur semble le médiateur entre l'homme et la mort. L'auteur n'hésite pas à l'écrire dans le conte intitulé " Sortilèges " : " J'eus la vision qu'au commencement, le monde, avant de surgir de l'informe, avait dû être une mer puissamment odorante " -et dans la première édition, l'auteur écrivait même : " avait été une odeur, rien d'autre ".
Dans l'un des contes les plus représentatifs de la manière de cet ouvrage, " Le jardin malade ", la Mort, pour exercer ses maléfices , prend les traits d'un effroyable chat appelé Tétanos, " à la tête plate presque d'un serpent, trouée de prunelles sanguinolentes par instant dilatées, puis s'éteignant dans une sanie blanche ". Avec son chien Milord, le conteur s'installe dans un vieil hôtel de maître, immense, arrivé à totale déchéance et promis à la démolition, flanqué d'un jardin inculte et indéchiffrable qu'habitent de mystérieuses bêtes maléfiques. Il y découvrira l'existence d'une petite fille, Ode ou Oda, créature effroyable, et d'une dame, la dame en gris, qui paraît être la garde-malade de l'enfant disgraciée. Puis, le drame prend corps. La petite fille descend dans le jardin malade et se lie avec le chien. Sous le regard de Tétanos qui les espionne, tous deux s'égarent dans le jardin maudit, menaçant, parcouru des signes de la mort et des prunelles du cauchemar. Dans un combat démoniaque, Milord sauve la fillette du chat en lui brisant les reins. C'est alors une plainte démente dans le silence nocturne : elle vient de plus bas que soi, de plus loin que le monde. Tétanos est revenu agoniser dans quelque coin de l'hôtel pour tourmenter ses hôtes. Puis, le démon poussant un râle interminable qui s'achèvera avec la mort de Milord, le silence retombe sépulcral.
Michel de Ghelderode demeure le spectateur inquiet " aux dents serrées et portant l'interrogation inscrite dans la peau de son front ". Ces contes sont réels, et leur puissance d'envoûtement tient plus à un certain art de ne pas dire ou de ne pas tout dire, qu'à celui de narrer méticuleusement avec le souci d'une vérité constante, un événement banal -un fait divers- se déroulant dans un lieu, un décor extraordinaire.
================================================================
Michel de Ghelderode 1898 - 1962
Auteur de quatre-vingts pièces, d’une centaine de contes et de poèmes, Michel de Ghelderode (Bruxelles, 1898-1962) a connu un immense succès auprès du public avec La Balade du Grand Macabre, Mademoiselle Jaïre et Barabbas. Ses pièces triomphent à Paris dans les années 1947-1953 et Ghelderode meurt au moment où l’Académie suédoise avait décidé de lui décerner le prix Nobel.