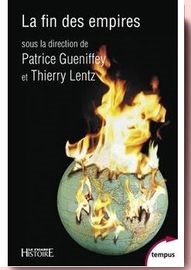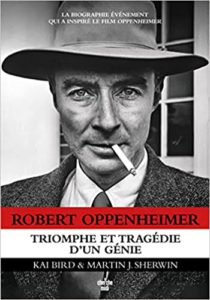Libres d’obéir
Le management, du nazisme à aujourd’hui
23 novembre 2020 : le nazisme a-t-il été « un grand moment managérial et une des matrices du management moderne » ? C’est la thèse que défend Johann Chapoutot dans son essai « Libres d’obéir » (Gallimard, 163 p., 16 €), à travers une analyse de la carrière de Reinhard Höhn, ancien juriste SS, créateur après-guerre d’une école de management prospère et reconnue.
D’emblée, l'historien pose que le management nazi a eu des développements dans l’Allemagne d’après-guerre et il raconte comment d’anciens hauts responsables de la SS en ont été les théoriciens « mais aussi les praticiens heureux ». À le lire, le mode de management « par la joie » (durch Freude) mis en place par les nazis est une notion encore « familière aujourd’hui », à l’heure où l’« engagement », la « motivation » et l’« implication » sont censés procédés du « plaisir » de travailler et de la « bienveillance » de la structure.
Le parallèle dérange mais pose utilement deux questions : celle de notre rapport à la liberté, souvent réduite au choix des moyens, et qui a de moins en moins prise sur les finalités poursuivies par les entreprises ou les dirigeants ; mais aussi la question de la neutralité du management, dans une économie qui, pour apporter la prospérité à une petite part de l’humanité, cause des dommages majeurs à d’autres êtres humains et à la planète.

L’intérêt des nazis pour le management découle d’abord de la nature de leur projet et des moyens qu’ils doivent mobiliser. Une armée qui multiplie ses effectifs « par plus de cinquante en quelques années a un fort besoin de cadres ». Cette croissance réduit d’autant les effectifs des administrateurs dont va avoir besoin un Reich devenu gigantesque (Riesenreich) grâce aux conquêtes militaires.
En 1941, le IIIe Reich s’étend des Pyrénées à la Baltique, domine l’Europe centrale jusqu’à la Grèce et occupe la partie européenne de l’URSS. Il faut donc faire plus avec moins d’hommes. Wilhelm Stuckart, docteur en droit et haut fonctionnaire nazi au ministère de l’Intérieur, en appelle à « l’initiative créatrice » et vante une organisation la plus décentralisée possible, schéma qui correspond à « l’essence et à l’identité allemandes ».
Cet héritage du Saint Empire romain germanique s’oppose évidemment à la centralisation française ou soviétique, cause de la « mort de l’esprit d’initiative et de la joie au travail »… Rien de tel dans le Reich allemand où « le centre de gravité de l’administration se situe dans les échelons inférieurs grâce à l’attribution de la plus grande marge de liberté à la décision et à l’initiative de l’individu ».
Pour faciliter les choses, des lois de simplification administrative ont été prises. Johann Chapoutot rappelle le « décret de simplification de l’administration » du 28 août 1939. Deux simples pages qui demandent une réduction des délais, réduisent les contrôles, élargissent le système d’accord tacite tout en réduisant les moyens et voies de recours des usagers de l’administration… Car les nazis, précise l’historien, sont des anti-étatistes convaincus.
Les querelles de compétences sont donc récurrentes et Hitler joue en permanence un rôle d’arbitre. L’historien y voit la marque d’un « darwinisme administratif » qui, s’il implique une perte importante de temps et d’énergie dans des initiatives concurrentes, présente l’intérêt d’entraîner l’ensemble du système dans une « logique de radicalité cumulative », selon une formule célèbre de l'historien Hans Mommsen. Cette radicalité cumulative serait, pour les dirigeants nazis, « par principe vertueuse » puisqu’elle correspond à leur vision du monde, lieu d’un combat permanent de tous contre tous.
 Les nazis en viennent à considérer que l’État peut n’être qu’un simple outil, voire même disparaître. Il est en effet concurrencé à partir de 1933 par une « myriade d’administrations ad hoc », des agences qui se voient dotées d’une mission et d’un budget « et dont l’existence est limitée au temps de cette tâche ».
Les nazis en viennent à considérer que l’État peut n’être qu’un simple outil, voire même disparaître. Il est en effet concurrencé à partir de 1933 par une « myriade d’administrations ad hoc », des agences qui se voient dotées d’une mission et d’un budget « et dont l’existence est limitée au temps de cette tâche ».
Reinhard Höhn est engagé dans la réflexion sur ces agences. D’abord proche de Carl Schmitt, le « maître des études de droit constitutionnel et de droit public », il s’en éloignera pour démontrer le caractère « obsolète » de l’État qui n’est plus pertinent à l’ère de la « communauté ». Il précisera dans un texte de 1938, Questions fondamentales pour la conception du droit, que « l’État n’est plus l’entité politique suprême » mais « un simple moyen qu’on engage et qui se voit assigné ses objectifs et son action ».
L’État doit donc passer de l’administration (Verwaltung), reliquat des « États princiers » et « héritage déplorable de l’Empire romain tardif », à la Menschführung, ou direction des hommes, « fluide et proactive », fruit du travail théorique des juristes nazis.

Un département « Beauté du travail »
Le système nazi exige beaucoup de ses travailleurs et le pouvoir ne veut pas voir se répéter des événements comme la révolte des tisserands silésiens de 1844 ou la révolution de 1918, toutes résultant de causes économiques.
Il faut donc créer une Menschführung « qui gratifie et promette, pour motiver, et créer une communauté productive ». Ce sera le but de l’organisation du « Travail par la joie », Kraft durch Freude (KdF), intégré au Front allemand du travail (Deutsche Arbeitsfront) qui a remplacé toutes les organisations syndicales dès le 2 mai 1933.
La KdF comprend un département « Beauté du travail » (Schönheit der Arbeit) qui est chargé d’une « réflexion portant sur la décoration, l’ergonomie, la sécurité au travail et les loisirs sur le lieu de production ». En six ans, de 1933 à 1939, « ce sont 200 millions de Reichsmarks (près d’un milliard d’euros actuels) » qui sont investis pour « améliorer l’éclairage, la ventilation, la nutrition des travailleurs » mais aussi pour créer des cantines ou des salles de sport.
Reinhard Höhn adhère dès mai 1933 au parti nazi, puis à la SS en juillet dont il intègre le service de sécurité (SD). Il a alors 29 ans. Deux ans auparavant, il est devenu docteur en droit avec une thèse portant sur le juge pénal pendant la Révolution française. « La communauté (Gemeinschaft) est son obsession : elle est à ses yeux la seule réalité existante et normative », écrit Johann Chapoutot. Cette radicalité lui permettra de supplanter Carl Schmitt, « irrémédiablement attaché à l’État, principe et fin de la vie juridique ».

Après 1945, Höhn se cache mais pour peu de temps. La loi d’amnistie du 31 décembre 1949 le blanchit de son passé, ainsi que 800 000 autres nazis. En 1953, Höhn se retrouve à un poste de direction de la Société allemande d’économie politique, une association qui vise à favoriser les méthodes de management les plus efficaces, avant de prendre en 1956 les rênes de l’Académie des cadres de Bad Harzburg par laquelle passeront 600 000 salariés.
Höhn est un passionné d’histoire militaire, dont il tire des enseignements qu’il transpose dans les leçons de management. Dans un ouvrage consacré à l’héritage de Scharnhorst, le réformateur de l'armée prussienne, il fustige le « positivisme militaire » et exige de se défaire de la tradition, dès lors qu’elle n’est plus adaptée aux circonstances présentes. À l’inverse, il loue « l’enthousiasme » dont font preuve les Français levés en masse en 1792, au point d’utiliser la phraséologie nazie de volonté fanatique (« fanatischer Wille ») pour les caractériser.
 Sur sa lancée, il tresse des louanges à Scharnhorst qui, après la défaite de Iéna en 1806, va réformer l’armée prussienne afin de pousser les officiers et les sous-officiers à « réfléchir aux moyens d’atteindre les objectifs fixés » grâce à la création d’une Académie.
Sur sa lancée, il tresse des louanges à Scharnhorst qui, après la défaite de Iéna en 1806, va réformer l’armée prussienne afin de pousser les officiers et les sous-officiers à « réfléchir aux moyens d’atteindre les objectifs fixés » grâce à la création d’une Académie.
Cette association entre un commandement autoritaire et la liberté laissée au corps d’officiers de terrain a été baptisée Auftragstaktik (la tactique par la mission). Un système à la fois efficace mais aussi « pervers » puisque « l’injonction, éminemment contradictoire, qui pesait sur l’encadrement de terrain, était d’être libre sans l’être aucunement », avec pour « corollaire (…) une responsabilité totale, absolue alors qu’il n’avait décidé de rien ».

Dans son école de management de Bad Harzburg, Reinhard Höhn va développer un enseignement inspiré de ses réflexions sur l’histoire militaire et de son passé nazi mais adapté aux temps démocratiques : ce sera le « management par délégation de responsabilité ». À l’instar de la politique nazie, ce nouveau management évacue la lutte des classes en considérant chacun non pas comme un « subordonné » mais comme un « collaborateur », « une personne qui agit et qui pense de manière autonome ».
Tout comme aux grandes heures nazies, il s’agit de « cultiver l’harmonie communautaire » entre direction (Führung) et personnel (Gefolgschaft) au sein de cette « communauté de production et de performance » qu’est l’entreprise. Johann Chapoutot rappelle cependant que le fonctionnement des organisations n’est plus « autoritaire, mais il reste pleinement hiérarchique ».
Le chef n’est plus là pour dire quoi faire mais pour fixer un objectif, puis observer, contrôler et évaluer. Le collaborateur « est libre de choisir les voies et les moyens les plus adaptés à l’exécution de sa mission », tout comme des officiers et sous-officiers dans le cadre de l’Aufstragtaktik mise au point par Scharnhorst.
Le passé SS resurgit en 1971
Selon l’historien, cette méthode de management « comme les méthodes de management par objectifs qui lui sont apparentées repose sur un mensonge fondamental, et fait dévier l’employé, ou le subordonné, d’une liberté promise vers une aliénation certaine, pour le plus grand confort de (…) cette « direction » qui ne porte plus elle seule la responsabilité de l’échec potentiel ou effectif. »
 Il souligne que cette méthode produit des « symptômes psychosociaux : anxiété, épuisement, "burn out" ainsi qu’une forme de démission intérieure que l’appelle désormais le "bore out" », à laquelle Reinhard Höhn a d’ailleurs consacré deux ouvrages en 1983, alors qu’il avait déjà atteint l’âge de... 79 ans.
Il souligne que cette méthode produit des « symptômes psychosociaux : anxiété, épuisement, "burn out" ainsi qu’une forme de démission intérieure que l’appelle désormais le "bore out" », à laquelle Reinhard Höhn a d’ailleurs consacré deux ouvrages en 1983, alors qu’il avait déjà atteint l’âge de... 79 ans.
Johann Chapoutot note aussi l’acuité de Höhn qui estime que l’administration n’est plus un modèle pour les entreprises mais doit au contraire « suivre une transformation dans laquelle l’économie l’a précédée ». Il en conclut que « le progrès est donc l’indifférenciation croissante entre administration et entreprise, secteur public et secteur privé ».
En 1971, un article de l’hebdomadaire Spiegel révèle le passé SS de Reinhard Höhn et porte un coup sévère au ponte du « management par délégation de responsabilité » qui voit la Bundeswehr cesser de lui envoyer ses cadres. Dans les années 70 et 80, l’étoile de l’école de Bad Harzburg commence à pâlir. Sa méthode est en effet jugée trop… bureaucratique.
En détaillant son modèle avec force études de cas, Reinhard Höhn demande aux cadres venus dans son école d’assimiler pas moins de... 315 règles d’application ! Bientôt son modèle est en perte de vitesse, dépassé par celui du « management par objectifs », élaboré par Peter Drucker, le pape du management made in USA.
Johann Chapoutot note malicieusement que « le professeur et ancien haut fonctionnaire SS ne sera pas parvenu à se défaire totalement d’un ethos administratif prussien, fait de contrôle (comme dans le management par objectifs), et riche de fichiers, de papiers, de règles et de tampons en tout genre ».
 Quelle fidélité a-t-il gardé à son passé nazi ? Pour l’historien, « Höhn n’a jamais abandonné son cadre conceptuel de référence, à la fois principe et idéal – celui de la communauté, fermée de préférence. C’est, de fait, une communauté de carrières, d’intuitions et de culture qui, après 1949, a « reconstruit » les fondements de la production économique, de l’État et de l’armée. »
Quelle fidélité a-t-il gardé à son passé nazi ? Pour l’historien, « Höhn n’a jamais abandonné son cadre conceptuel de référence, à la fois principe et idéal – celui de la communauté, fermée de préférence. C’est, de fait, une communauté de carrières, d’intuitions et de culture qui, après 1949, a « reconstruit » les fondements de la production économique, de l’État et de l’armée. »
Malgré la désaffection qu’a subie la méthode mise au point par Höhn, elle garde de fervents admirateurs et produit malheureusement des dégâts considérables comme l’a démontré Andreas Straub, un ancien cadre de la chaîne de supermarchés Aldi, dans un livre relatant son expérience (Aldi au rabais. Un ancien manager déballe tout). Commentant son ancienne entreprise, il dira : « Le système vit du contrôle total et de la peur. »
Concluant sur la période actuelle, Johann Chapoutot estime que désormais, « l’horizon, purement immanent, se résume à la production et au profit ou, plus précisément, à l’augmentation de l’une et à l’optimisation de l’autre », à base de méthodes de « management par objectifs ». Il dresse un parallèle avec l’Allemagne nazie, un régime « participatif car il visait à produire du consensus », et qui a « encouragé et financé travaux et réflexions sur un mode d’organisation non autoritaire ». Et il note, avec une pointe de désespoir, que les vocables nazis (haute croissance, productivité, compétition) « sont trop souvent les nôtres aujourd’hui ».
Certes, les nazis ne les ont pas inventés « mais ils les ont incarnés et illustrés d’une manière qui devrait nous conduire à réfléchir sur ce que nous sommes, pensons et faisons ». Une invitation que ce livre peut largement favoriser. En tout cas pour ceux qui croient encore que l’existence ne se résume pas à un combat sans fin dont le seul but serait d’éphémères gains de compétitivité afin de préserver sa place dans le classement économique mondial.
Poutine historien en chef
L'historien Nicolas Werth s'en va-t-en-guerre
L’historien Nicolas Werth prend sa part dans le conflit entre l’Europe et la Russie. Il vient de publier un petit texte à charge contre l’hôte du Kremlin : Poutine historien en chef (Tracts, Gallimard).
Si grande que soit la répulsion qu’inspire le président russe et même si les Ukrainiens nous inspirent plus d’affliction que les Irakiens assaillis par Bush Jr en 2003, un historien se doit de rester au-dessus de la mêlée. Ce n’est pas son cas...
 Spécialiste de l’Union soviétique connu pour sa participation au Livre noir du communisme (Robert Laffont, 1997), Nicolas Werth a évalué à quinze millions le nombre des victimes du système soviétique tout en réfutant un parallèle entre communisme et nazisme (note).
Spécialiste de l’Union soviétique connu pour sa participation au Livre noir du communisme (Robert Laffont, 1997), Nicolas Werth a évalué à quinze millions le nombre des victimes du système soviétique tout en réfutant un parallèle entre communisme et nazisme (note).
Représentant de l’ONG Mémorial en France, il a milité avec elle pour que soit mise à jour la vérité sur les crimes passés.
Mémorial a été fondée par le Prix Nobel de la Paix Andreï Sakharov en 1989, quelques mois avant sa mort, afin de réunir archives et témoignages sur les crimes du communisme. Mais au lendemain de l'annexion de la Crimée en 2014, des lois mémorielles ont criminalisé « la profanation des symboles de la gloire militaire de la Russie ». Il s'ensuit que l'association est entrée dans l'opposition au président Poutine avant d'être dissoute le 29 décembre 2021.
« Pour Vladimir Poutine, le contrôle de la mémoire historique, de l’interprétation du passé, est un enjeu essentiel », écrit l'historien, mais pour quel homme d’État ne l’est-ce pas ? Tous les gouvernants de la planète s’appliquent à ne retenir du passé que les faits conformes à leurs objectifs politiques.
En France, la droite se plaît à cultiver le « roman national » tissé de grandeur et d’héroïsme ; la gauche se plaît à le déconstruire pour ne retenir que le côté sombre de l’Histoire nationale. Mais suivant la remarque de Raymond Aron, « qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on est toujours hémiplégique ». Le texte de Nicolas Werth illustre cette hémiplégie par son caractère univoque.
Instruction à charge
L’Histoire s’est brusquement accélérée le 24 février 2022. Dans Les Causes politiques de la guerre, j’ai décrit par le détail l’enchaînement de circonstances qui a conduit la Russie à assaillir l’Ukraine. L’Europe a ipso facto refait son unité dans le soutien à l’Ukraine martyrisée. Le président Macron lui-même a dû remiser ses doutes et s’aligner sur les « faucons » de Washington. Une page est tournée et il n’y a plus guère d’espoir de réintégrer la Russie dans la famille européenne.
Ce drame complexe réclame de la nuance de la part d’un historien. C’est le contraire que nous offre Nicolas Werth en ne retenant que les faits qui vont dans le sens de sa démonstration et en se gardant de les comparer à d’autres faits similaires dans d’autres pays.
Ainsi instille-t-il l’idée que Poutine - et lui seul - manipule l’Histoire. Il le charge aussi de « crimes contre l’histoire » en reprenant le rapport de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH). D’après la définition qui en est donnée, ces « crimes contre l’histoire » concernent la plupart des pays. Ils relèvent en effet de : la promulgation de lois répressives supprimant la liberté d’expression sur les questions historiques (la France fut précurseur en la matière avec la loi Gayssot de 1989 réprimant le négationnisme) ; le refus d’accès aux archives (tous les États limitent l’accès à leurs archives récentes ou sensibles) ; la destruction de monuments commémoratifs (ce phénomène de mode est pratiqué avec zèle par l’Ukraine depuis plusieurs décennies), etc.
----------------------------------------------------------------------------
Martin Bormann
Homme de confiance d'Hitler
 Armé d’une foi inébranlable dans la doctrine nazie, Martin Bormann fait toute sa carrière au sein du NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs allemands). Secrétaire au siège du parti à l’âge de 29 ans, il sera ensuite au service de Rudolf Hess jusqu’à l’incursion de son chef en Angleterre, parti conclure une improbable paix séparée…
Armé d’une foi inébranlable dans la doctrine nazie, Martin Bormann fait toute sa carrière au sein du NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs allemands). Secrétaire au siège du parti à l’âge de 29 ans, il sera ensuite au service de Rudolf Hess jusqu’à l’incursion de son chef en Angleterre, parti conclure une improbable paix séparée…
Loin de pâtir de cette initiative pour le moins hasardeuse, Martin Bormann se voit projeter dans le cercle des intimes de Hitler puisqu’il devient son secrétaire à partir de 1943 et le restera jusqu’à l’effondrement final.
Malgré cette position éminente, aucun historien français ne lui avait encore consacré de biographie. François Delpla a comblé cette lacune. Dans son dernier ouvrage, Martin Bormann. Homme de confiance d’Hitler (Nouveau Monde éditions, 2020), il brosse le portrait et retrace la carrière de ce nazi qui aura connu Hitler bien mieux que la plupart de ceux qui l’ont côtoyé...
Un employé de bureau
Martin Bormann est le moins en vue des dirigeants nazis. C’est un pur bureaucrate, qui ne fait pas de discours et n’est jamais mis en valeur par la propagande. Il a pourtant une grande autorité à la fin de la guerre. Son titre de « secrétaire du Führer », obtenu le 12 avril 1943, donne à sa signature force de loi dans tous les domaines.
Découvert par le public après l’effondrement du Reich, chargé de beaucoup de crimes par les autres nazis au tribunal de Nuremberg (alors qu’on ignorait s’il était mort ou vivant), il n’a, si surprenant que cela paraisse, jamais inspiré à un historien le moindre livre ni même le plus petit article, avant la biographie que je lui ai consacrée en 2020. Il en existait seulement quelques-unes dues à des journalistes et dont les historiens se servaient sans excès d’esprit critique.
On le voyait comme un hiérarque assoiffé de pouvoir et inlassable tisseur d’intrigues qui ne cessait de dire à Hitler du mal des autres dirigeants, pour accaparer leurs fonctions. Il aurait fini par leur barrer la porte du Führer en prenant le contrôle de son agenda. Or tout cela est faux !
 Né en 1900, doté d’un bagage scolaire très mince, Martin Bormann est embauché en 1928 au siège du parti nazi comme employé de bureau. Il va s’élever dans la hiérarchie par ses qualités : dévouement, obéissance, puissance de travail, convictions idéologiques, mémoire, loyauté, sens de l’organisation, rigueur financière.
Né en 1900, doté d’un bagage scolaire très mince, Martin Bormann est embauché en 1928 au siège du parti nazi comme employé de bureau. Il va s’élever dans la hiérarchie par ses qualités : dévouement, obéissance, puissance de travail, convictions idéologiques, mémoire, loyauté, sens de l’organisation, rigueur financière.
Il ne s’agit pas de le réhabiliter puisque ces qualités sont mises au service d’un criminel, dont les ordres d’assassinat furent appliqués sans discussion. Car Bormann était convaincu qu’Hitler allait restaurer la puissance de l’Allemagne puis, quand vinrent les revers, que lui seul pourrait la sauver !
Le chef adjoint des SA, Otto Wagener, confie en 1929 à Martin Bormann sa première responsabilité importante, la direction de la caisse d’assurance du parti, laquelle dégage des bénéfices bienvenus pour un parti submergé de difficultés financières.
Il se fait aussi remarquer d’Hitler en épousant Gerda Buch, la fille d’un des premiers nazis, Walter Buch, inamovible président du tribunal interne du parti, avec pour témoins Rudolf Hess et Hitler lui-même.
Hess, qui prend la direction du parti quand Hitler devient chancelier, l’appelle à ses côtés comme chef d’état-major. Bormann noue alors des relations étroites avec les responsables provinciaux appelés gauleiters. Il est parallèlement embauché par Hitler pour gérer sa fortune et une partie de ses biens, notamment en matière immobilière.
C’est ainsi qu’il dirige l’acquisition des terrains et la construction des bâtiments du domaine de Berchtesgaden, mais aussi de celui d’Alt Rehse (près de Berlin), voué à l’endoctrinement nazi des personnels de santé, et du complexe de Pullach (près de Munich), où réside l’élite des cadres du parti.
Si rien n’indique chez lui une obsession antisémite (ni, toutefois, une opposition dans ce domaine, qui l’eût fait congédier sur l’heure par Hitler), il est en revanche viscéralement anti-chrétien et partie prenante non seulement dans la persécution des clercs mais dans l’euthanasie, qui prétend améliorer la race en disposant des corps, par la stérilisation puis, en temps de guerre, par le meurtre. Son compagnonnage avec les médecins nazis en général, et les médecins SS en particulier, est abondamment documenté.

Ses responsabilités augmentent brusquement en mai 1941 quand Rudolf Hess disparaît aux commandes d’un avion pour tenter de rétablir la paix avec l’Angleterre avant l’invasion de l’URSS. Il lui succède à la tête du parti, avec le titre de « chef de la chancellerie du NSDAP ».
Sa proximité avec Hitler, déjà grande depuis le début de la guerre, devient presque une symbiose lors de l’opération Barbarossa. C’est alors qu’il commence à faire noter les propos du chef, qui dans les années 1950 deviendront un livre couramment désigné par une expression trompeuse empruntée à… Martin Luther : « Propos de table » (Tischreden).
En fait, il ne retient de la logorrhée hitlérienne, recueillie à toute heure, que ce qui peut servir de directive, et l’exploite dans des circulaires aux gauleiters ou, de plus en plus, dans des lettres à différents dirigeants. C’est ainsi que, petit à petit, il accède à une fonction de secrétaire du Führer avant d’en recevoir officiellement le titre, peu après le désastre de Stalingrad.
 Pendant tout ce processus, il augmente certes sa puissance et son autorité, mais non, à proprement parler, son pouvoir : il reste suspendu aux décisions d’un chef et d’un seul, qu’il a à cœur de servir le mieux possible, comme il l’écrit à son épouse Gerda. Leur correspondance, fréquente et abordant bien des sujets (mais hélas conservée seulement pour les deux dernières années), permet de constater que ses fonctions ne lui montent pas à la tête, et que son abnégation ne faiblit jamais.
Pendant tout ce processus, il augmente certes sa puissance et son autorité, mais non, à proprement parler, son pouvoir : il reste suspendu aux décisions d’un chef et d’un seul, qu’il a à cœur de servir le mieux possible, comme il l’écrit à son épouse Gerda. Leur correspondance, fréquente et abordant bien des sujets (mais hélas conservée seulement pour les deux dernières années), permet de constater que ses fonctions ne lui montent pas à la tête, et que son abnégation ne faiblit jamais.
S’il y a entre les dirigeants nazis des rivalités, souvent exagérées mais néanmoins réelles, Bormann est probablement, parmi eux, le plus soucieux d’action collective. C’est la meilleure explication de son ascension qui procède moins d’une volonté de s’élever que du besoin, éprouvé de façon croissante par Hitler à mesure que la situation militaire se détériore, d’avoir auprès de lui un interprète scrupuleux de sa volonté du moment, capable de la faire connaître et respecter dans tous les rouages de l’État.
« Abgabeaktion »
De ce point de vue, il éclipse peu à peu, pendant les dernières années, un autre dirigeant, Hans Lammers, chef de la chancellerie du Reich. Ce dernier est une sorte de directeur de cabinet chargé depuis 1933 de répercuter les desiderata du chancelier auprès de ses ministres. Une fois nommé « secrétaire du Führer », Bormann devient, de fait, le supérieur de Lammers qui, après une résistance initiale, se résigne à cette situation.
Le totalitarisme hitlérien restait, jusqu’au début de 1942, incomplet dans le domaine judiciaire. Le ministre de la Justice Franz Gürtner, un conservateur, avait maintenu une relative indépendance de la magistrature (fortement incitée, cependant, à juger selon des critères nazis). Il meurt en janvier 1941 (il faudrait d’ailleurs peut-être s’interroger sur les causes de ce décès) et n’est pas remplacé avant juillet de l’année suivante.
Dans l’intervalle, Hitler a essayé de mettre l’URSS au tapis comme la France un an plus tôt, et échoué. Ses confidences montrent dès l’automne de 1941 et dès avant l’attaque japonaise de Pearl Harbor, qui scelle l’entente des « Trois grands » (Grande-Bretagne, États-Unis et URSS) contre lui, que la guerre est perdue, à moins qu’il ne parvienne à empêcher cette alliance ou, si elle se confirme, à la dissoudre. En conséquence, il anticipe dès ce moment des temps difficiles à l’intérieur même du Reich, et prévoit des mesures répressives pour y parer.
Le mouvement SS est, dans ce domaine, son instrument favori et il lui donne pour cela de nouveaux leviers, comme la nomination de son chef, Himmler, au ministère de l’Intérieur en 1943. Mais il en donne aussi à Bormann, dont les relations avec Himmler sont complexes, mais beaucoup plus amicales et synergiques qu’on ne le dit généralement, notamment en matière de justice.

S’étant fait accorder par le Reichstag les pleins pouvoirs dans ce domaine en avril 1942, Hitler associe de près Bormann à la nomination en juillet du successeur de Gürtner : le nazi fanatique Otto Thierack. Ils réorganisent de concert le ministère pendant l’automne en contraignant les juges à rendre des verdicts conformes aux intérêts militaires et « raciaux » du pays et en les dessaisissant partiellement au profit des SS.
Ainsi est décidée en septembre 1942 une réforme importante, et méconnue de l’historiographie, appelée Abgabeaktion (« action de prélèvement »). Elle consiste à prélever dans les prisons des délinquants « asociaux » pour les remettre aux SS qui, dans leurs camps de concentration, les mettront à mort « par le travail ».
Une réforme typiquement nazie, consistant à la fois à terroriser le peuple allemand et à profiter de la guerre, et de ses difficultés même, pour prendre des mesures drastiques d’« amélioration de la race ». La documentation montre que Bormann sert d’intermédiaire sur ce chapitre entre Thierack et Himmler d’une part, et Hitler de l’autre.
Après le désastre de Stalingrad, consommé le 2 février 1943 par la reddition des dernières troupes du maréchal Paulus, on sait que le gouvernement du Reich proclame la « guerre totale » par la voix de Goebbels en un discours très médiatisé devant le Reichstag, le 18 février 1943.
On sait moins que depuis janvier siège un « comité des trois » composé de Bormann, de Lammers et du maréchal Keitel, qui gère ce processus en freinant les mesures souhaitées par Goebbels et ses quelques alliés, principalement le ministre de l’Armement Albert Speer, notamment l’extension du travail féminin.
D’un côté, on affiche des mesures drastiques de mobilisation, de l’autre les femmes allemandes sont, comme avant ou presque, vouées principalement à leurs tâches reproductrices. Comble d’infortune, Goebbels, qui veut s’attaquer à la coquetterie féminine, ne réussit même pas à faire interdire le maquillage et les permanentes, mais seulement à suspendre la fabrication des produits nécessaires.
 Ces exemples, et d’autres détaillés dans mon livre, permettent de dissiper l’image d’un régime « polycratique », qui a trompé et trompe encore beaucoup d’historiens du nazisme. Les rivalités des dirigeants et de leurs bureaucraties, souvent surestimées, sont, de plus, corsetées et orientées en fonction des vues, souvent secrètes, du dictateur, et de ses méthodes souvent obliques.
Ces exemples, et d’autres détaillés dans mon livre, permettent de dissiper l’image d’un régime « polycratique », qui a trompé et trompe encore beaucoup d’historiens du nazisme. Les rivalités des dirigeants et de leurs bureaucraties, souvent surestimées, sont, de plus, corsetées et orientées en fonction des vues, souvent secrètes, du dictateur, et de ses méthodes souvent obliques.
L’ascension de Bormann n’est qu’un symptôme de ce contrôle, et de sa nécessité croissante au fur et à mesure que la guerre tourne au désavantage du pays. Pour autant, le « secrétaire » nommé le 12 avril 1943 n’est pas dans tous les secrets. Bormann reste, à sa façon, un idéaliste, incapable d’appréhender complètement le cynisme de son maître.
Rien n’en témoigne mieux que leur unique dispute, à notre connaissance. Martin la conte par le menu dans une lettre à Gerda, le 18 août 1944. Hitler crée un ministère de la Santé et en confie la direction à Karl Brandt, l’un des médecins les plus fanatiquement nazis.
Göring est un traître...
Jusque-là, il n’existait qu’une direction de la santé au ministère de l’Intérieur, confiée à Leonardo Conti. Bormann se rebelle, par amitié pour Conti qu’il estime beaucoup plus compétent et dévoué. Karl Brandt, explique-t-il à Hitler, n’est qu’un arriviste et un intrigant. Il met sa démission dans la balance, demandant à être envoyé sur le front si Hitler maintient sa décision.
Lorsqu’il rédige sa lettre, Bormann ne sait encore s’il va conserver ses fonctions. Il écrit dans la lettre suivante qu’il est rassuré car son maître est tout miel avec lui : la crise est passée ! Les deux hommes sont trop vissés l’un à l’autre.
 Hitler a pris, comme souvent, un gros risque (celui de perdre un collaborateur quasi-indispensable), mais, comme presque toujours (sauf lorsqu’il a sous-estimé la capacité de Churchill à maintenir l’état de guerre en mai-juin 1940), il gagne sur toute la ligne : il aura, et Bormann comme secrétaire, et Brandt comme commissaire du Reich à la Santé.
Hitler a pris, comme souvent, un gros risque (celui de perdre un collaborateur quasi-indispensable), mais, comme presque toujours (sauf lorsqu’il a sous-estimé la capacité de Churchill à maintenir l’état de guerre en mai-juin 1940), il gagne sur toute la ligne : il aura, et Bormann comme secrétaire, et Brandt comme commissaire du Reich à la Santé.
Il est difficile, à partir de ce seul document, de savoir pourquoi il tenait tant à Brandt, mais on sait par ailleurs qu’il envisageait d’utiliser des gaz de combat et a chargé Brandt d’expérimentations dans ce domaine. Il aura jugé ce nazi fanatique, l’un des rares à crâner en dénonçant une « justice de vainqueurs » au pied de la potence de Nuremberg, plus apte à cette besogne que Conti (qui devait se suicider en prison).
Voilà qui nous amène à la période finale du nazisme, quand l’Allemagne est prise en étau par les Alliés de l’Est et de l’Ouest. On sait que sa politique officielle consiste à « combattre jusqu’au bout » sans négocier d’aucun côté.
En fait, des tentatives de négociations ont tout de même lieu, par Himmler côté occidental, par Ribbentrop en direction de l’Est… Il est grotesque (et démenti par les documents quand on les lit de près) de penser qu’Hitler n’aurait pas été au courant. En revanche, rien n’indique que Bormann le soit et, quand il est informé de ces négociations, son indignation n’a pas l’air feinte.
Il est par exemple sincère lorsque, le 23 avril 1945, il veut persuader Hitler que Göring le trahit (dans un message, le successeur désigné d’Hitler demandait seulement quand il était censé prendre ses fonctions, étant donné que le dictateur entendait « diriger la défense de Berlin » et y mourir en cas d’échec).
Il ne veut pas, comme on l’a souvent écrit, succéder au successeur, mais seulement lui appliquer le châtiment des traîtres, à un moment où des patrouilles de SS parcourent Berlin en pendant aux réverbères ceux qui parlent de se rendre.

Hitler ne réagit pas tout de suite dans le sens souhaité mais finit au bout de quelques heures par déchoir Göring de ses fonctions, tout en lui laissant la vie sauve « en reconnaissance des services rendus ».
Un rôle décisif est alors joué par un nazi peu connu, qui allait plus tard faire une brillante carrière au sein du « miracle économique » ouest-allemand, Helmut von Hummel (1910-2012). Il est le bras droit de Bormann dans la gestion du domaine de Berchtesgaden et a aussi un lien personnel avec Hitler, dont il pilote les acquisitions d’œuvres d’art.
Göring étant assigné à résidence sous la garde des SS dans sa villa de Berchtesgaden, Hummel s’arrange avec le chef local des SS pour qu’il ne soit pas exécuté, même si un télégramme de Bormann l’ordonnait. C’est ainsi que, lorsque le 26 avril arrive, signé du secrétaire, l’ordre de « fusiller tous les traîtres » si Berlin tombe, le prisonnier a été transféré et ne dépend plus des autorités de Berchtesgaden.
Cette affaire tend à prouver qu’Hitler, tout en maintenant les apparences d’un absurde jusqu’auboutisme, garde Göring en réserve pour négocier avec les Américains (chez qui Göring se rend dès la capitulation ordonnée par Dönitz le 7 mai) et sauver du nazisme ce qui pourra l’être, en attendant une renaissance promise par son testament. Ici, Bormann, secrétaire tenu à l’écart des secrets, est naïvement fidèle à la politique officielle.
Après le suicide de son idole, qui l’a chargé de se rendre à Flensburg auprès du nouveau successeur désigné, l’amiral Dönitz, Bormann tente de quitter Berlin en franchissant les lignes soviétiques, mais renonce rapidement et se suicide au cyanure.
L’envahisseur fait enterrer prestement les cadavres qui jonchent les rues et le sien n’est pas identifié. Voilà qui, joint à sa réputation de maître de l’intrigue, autorise le mythe de sa survie, en Amérique latine ou ailleurs, à la tête d’une clique nazie préparant un triomphal retour en RFA. Même la découverte de son squelette, en 1972, ne mit pas fin aux rumeurs, qui ne cessèrent qu’après le verdict de l’ADN, en 1999.
Ce premier examen historique de son parcours, qui en appelle d’autres, est un vecteur de choix pour cerner la manière de gouverner d’Hitler et combattre un mythe qui, contrairement à celui de la survie de Bormann, reste vivace : la présentation du Troisième Reich comme une « polycratie ».